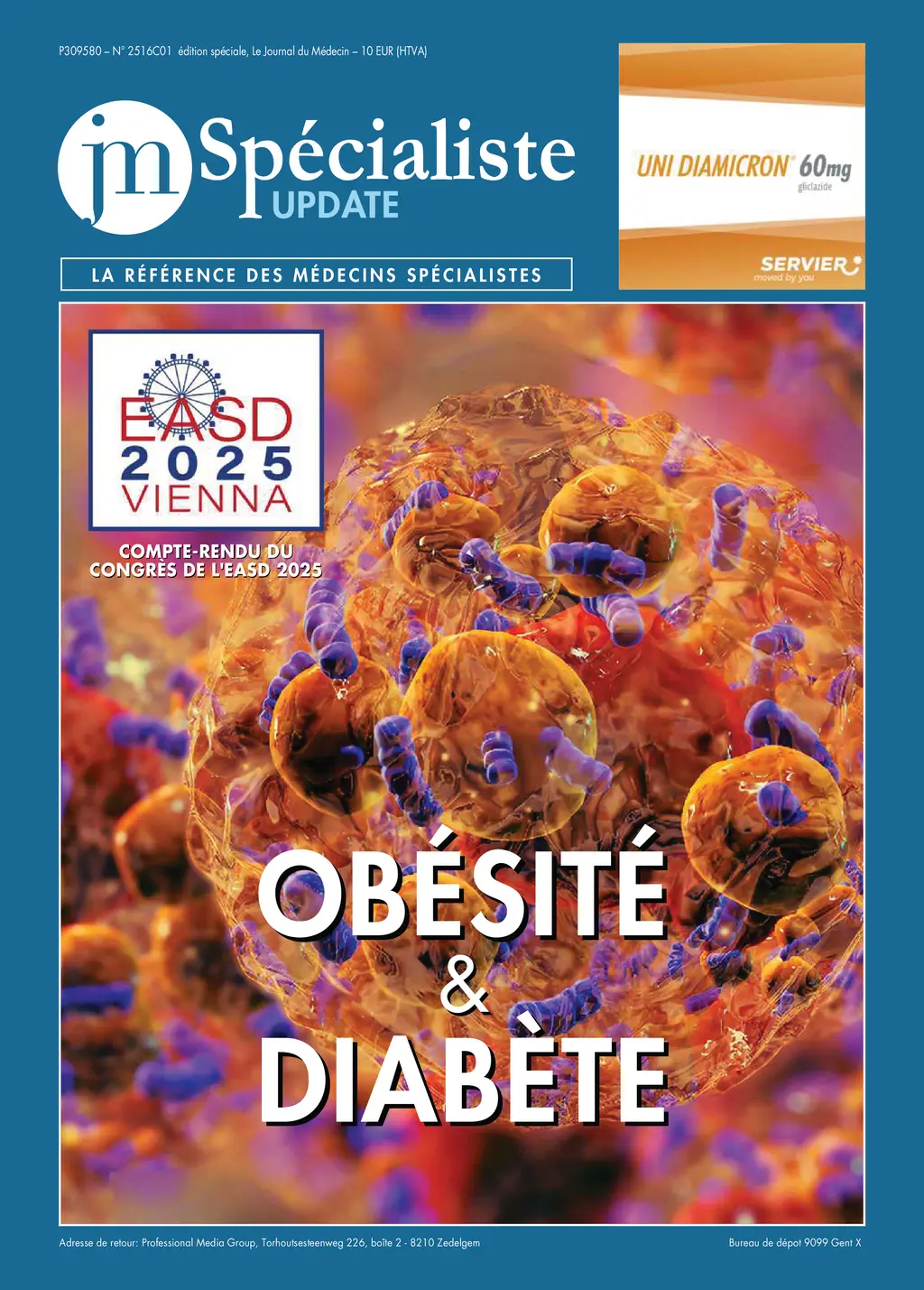PFAS: les tests sanguins individuels peu utiles pour la santé, mais ils peuvent faire avancer la science
2 juillet 2025 - Pour aider les professionnels de la santé à accompagner les citoyens qui pourraient présenter des concentrations élevées en PFAS, la Conférence interministérielle santé publique a chargé le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) de formuler des recommandations sur la pertinence du dépistage individuel de ces composés dans le sang. Dans l’état actuel des connaissances, les experts concluent que ce dépistage n’est pas opportun, sauf à des fins de recherche scientifique.

"Faire progresser nos connaissances sur les PFAS est par contre absolument essentiel", souligne le KCE dans son rapport publié ce mardi. On le sait, ces substances per- et polyfluoroalkylées sont associées à divers problèmes de santé comme des troubles du système immunitaire, une hausse du cholestérol et un risque accru de certains cancers. Même si de nombreux aspects restent flous (durée d’exposition, dose, type de PFAS, gravité des effets), ces signaux justifient une approche prudente. C’est pourquoi des mesures sont déjà en place depuis plusieurs années pour limiter leur production, leur usage et l’exposition de la population — par exemple via des seuils maximum dans l’eau potable.
Ces derniers mois, on a assisté à plusieurs campagnes de dépistage sanguin individuel dans des régions où le taux de ces composés chimiques synthétiques est particulièrement élevé. Objectif avoué: dépister les contaminations pour réduire leur impact sur la santé via une prise en charge médicale adaptée. Mais cette démarche est-elle pertinente ?
Quatre critères... mais aucune donnée solide
Pour évaluer la pertinence du dépistage individuel, les experts du KCE sont partis de quatre interrogations:
- Y a-t-il des preuves solides de lien entre les PFAS et une/des maladies graves ?
- A partir de quels seuils de concentration sanguine représentent-ils un risque pour la santé ?
- Avons-nous des tests simples, précis et validés ? Savons-nous quels PFAS rechercher parmi les milliers qui existent ?
- Si une personne présente des taux élevés de PFAS dans le sang, disposons-nous de moyens efficaces pour limiter l’impact de la contamination à titre individuel ?
LIRE LE RAPPORT EN INTÉGRALITÉ
L'étude du KCE conclut que pour le moment, aucune donnée solide ne permet de répondre clairement à ces questions... "Nous ne disposons pas de données sur l'évolution du risque individuel de développer certaines maladies graves en fonction du niveau sanguin de PFAS", reconnaissent les experts. "Par ailleurs, il n’existe pas encore de méthode de référence pour mesurer la concentration de PFAS dans le sang, ni de consensus sur la liste des PFAS à rechercher."
Enfin, il n’y a pas, non plus, de vue claire sur la prise en charge médicale la plus pertinente en cas de concentration sanguine élevée de PFAS. Retour à la case départ, donc...
Un programme de recherche, plutôt que des dépistages tous azimuts
Vu le peu d'intérêt réel du dépistage individuel pour la santé du patient et vu, aussi, son impact important, tant financier que psychologique, le KCE ne recommande pas, "à ce stade", d’effectuer des prises de sang pour mesurer les taux de PFAS à l’échelon individuel. "Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il faut rester les bras croisés. Il est indispensable de développer nos connaissances, notamment en matière de quantification des risques de santé associés, de seuils de concentration sanguine au-delà desquels une maladie grave peut apparaître, les mesures vraiment utiles en termes de prévention, d’interventions ou de suivi médical, les modalités concrètes des tests, etc."
Les experts conseillent par contre aux autorités d'investir dans la recherche - un programme de recherche scientifique interfédéral ambitieux, structuré et coordonné –, éventuellement en collaboration au niveau européen, vu que le problème est universel. Là, des échantillons sanguins pourraient servir la science.
"Si, il existe bien des données scientifiques..."
Pourtant, selon la Pre Anne-Simone Parent, endocrinologue pédiatrique au CHU Liège, présidente de la Task force perturbateurs endocriniens de l'Endocrine Society, des données solides sur les effets des PFAS sur la santé existent bel et bien. Interpellée par la Cellule environnement de la SSMG, la spécialiste explique: "Ces données-là, elles existent. Et l’intérêt de mesurer les PFAS, c’est de pouvoir fournir des recommandations de suivi à long terme chez des individus qui auraient été exposés à des doses élevées de PFAS. Le risque d’un texte sous cette forme est de retarder des mesures de protection pour la santé" alors que le principe de précaution devrait s’appliquer dans ce cas-ci."
Lire par ailleurs: Perturbateurs endocriniens : mieux vaut les retirer que définir des doses limites
La SSMG ajoute, par la voix de Cécile Bertrand, son experte en santé de l'environnement: "Les données sont foisonnantes. Notamment sur les impacts potentiels sur la thyroïde, sur le foie, les reins, l'immunité, mais aussi chez les femmes enceintes, dont les risques de pré-éclampsie, un impact sur la croissance du fœtus, sur le développement et la fertilité. Les expositions précoces sont très dommageables. On a vraiment un haut niveau de certitude pour ces données-là. Les PFAS seraient aussi des polluants obésogènes."
En résumé, selon le KCE, pour les professionnels de la santé :
- Certaines études épidémiologiques montrent une association entre l’exposition aux PFAS et plusieurs effets sanitaires : dyslipidémie, réduction de la réponse vaccinale, faible poids de naissance et augmentation du risque de cancer du rein.
- Les données actuelles sont insuffisantes pour recommander un dépistage sanguin systématique en médecine générale, en raison de l’incertitude sur la valeur prédictive des tests.
- Il n’existe pas de méthode de dosage standardisée ni de consensus sur les seuils cliniquement pertinents de concentration sanguine.
- Les seuils utilisés (HBM-I, HBM-II, NASEM) sont fondés sur des effets populationnels et ne permettent pas d’évaluer le risque individuel de maladie.
- Les recommandations américaines (NASEM) pour le suivi clinique en fonction des niveaux de PFAS sont reprises en Belgique mais ne sont pas toutes evidence-based.
- Il est crucial d'éviter d’alimenter l’anxiété des patients par des tests peu interprétables, surtout en l’absence d’options thérapeutiques validées.
- La décision de tester les PFAS doit être partagée avec le patient et justifiée par le contexte, par exemple une anxiété forte ou une grossesse.
- Un kit d’information harmonisé et validé pour les professionnels de santé est recommandé afin de répondre de manière cohérente aux demandes des patients.
- Le rapport insiste sur la nécessité d’un programme de recherche coordonné, national et européen, pour améliorer les connaissances et les pratiques cliniques.