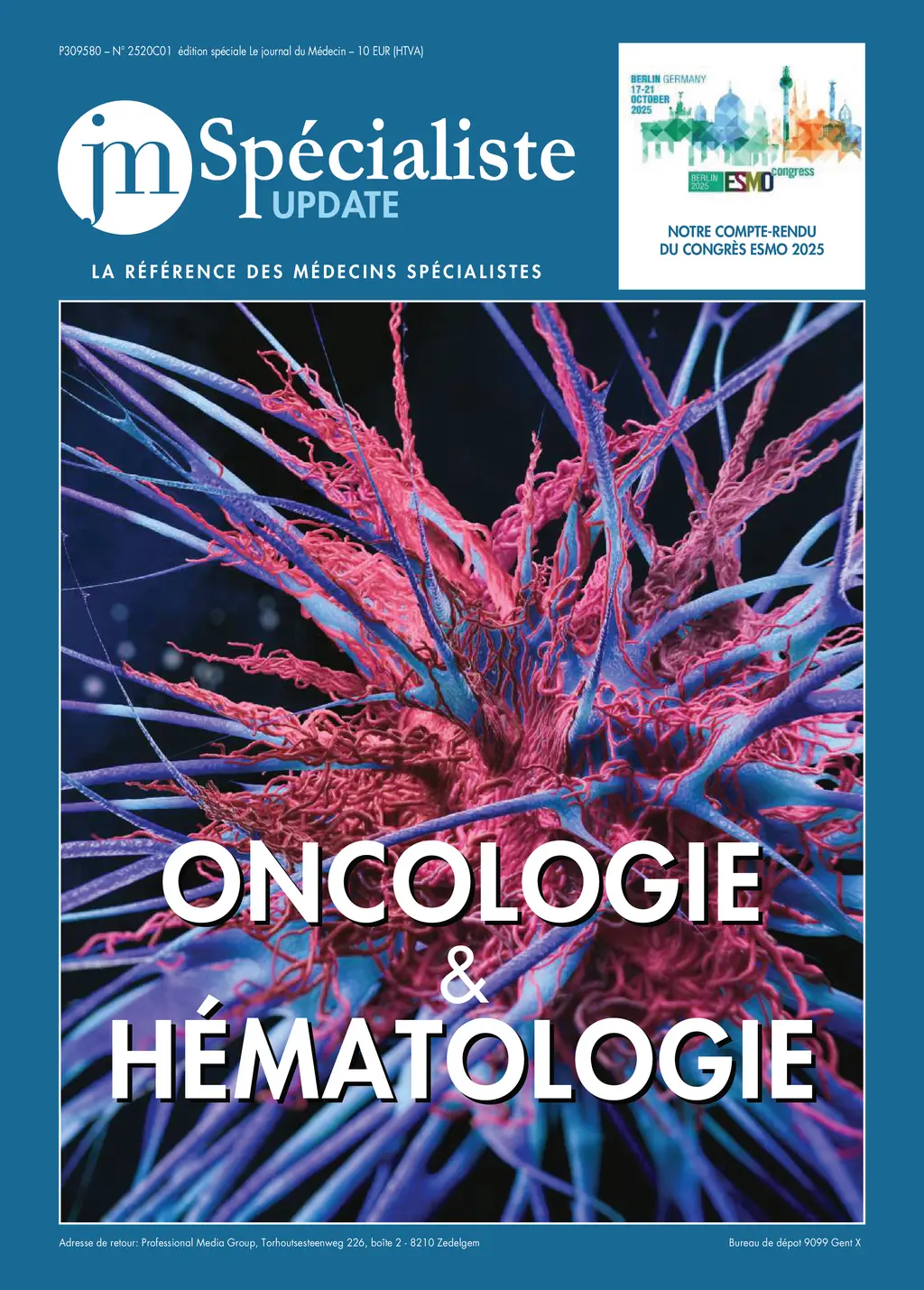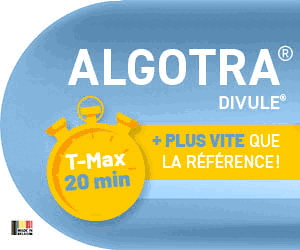Comment interpréter et appliquer les données des "baromètres"?
Les médecins généralistes disposent de plus en plus d’informations sur le fonctionnement de leur cabinet grâce à divers baromètres. Mais comment lire et interpréter correctement ces informations en tant que médecin généraliste ? Et comment traduire ces connaissances en actions concrètes sur le terrain ?
Les docteurs Bert Vaes (KU Leuven) et Steve Van Den Bulck (UHasselt), accompagnés de la doctorante Justine Soetaert (KU Leuven), apporteront des réponses à ces questions lors de la prochaine Conférence des médecins généralistes organisée en Flandre par Domus Medica.
Vers une approche plus proactive
Les généralistes travaillent souvent de manière réactive : ils aident au mieux les patients qui se présentent avec une plainte, un symptôme ou une question. Mais le vieillissement de la population, accompagné d’un nombre croissant de personnes atteintes de maladies chroniques et de comorbidités, crée un besoin urgent d’une approche plus proactive dans les cabinets. Pour cela, des données claires et facilement accessibles sont indispensables.
« Actuellement, trois baromètres sont disponibles pour les médecins généralistes : le baromètre du diabète, le baromètre des antibiotiques et le baromètre de l’insuffisance rénale », explique Bert Vaes. « Ils sont alimentés automatiquement par les données du DMI (dossier médical informatisé), mises à disposition par les cabinets. Pour ce partage de données, les cabinets reçoivent une incitation financière via la prime de pratique intégrée. Ces baromètres permettent de visualiser les tendances dans son propre cabinet. Pourtant, nous constatons que, malgré leur participation, seuls peu de cabinets exploitent déjà activement ces données. »
Durant la conférence, Bert Vaes, Steve Van Den Bulck et Justine Soetaert illustreront, à partir d’exemples pratiques, comment lire et interpréter ces baromètres, comment définir des objectifs collectifs au sein de l’équipe, comment convertir les données en actions concrètes et comment évaluer leur impact.
Une idée accélérée par la pandémie
Le concept des baromètres existait déjà, mais a réellement pris forme pendant la pandémie de covid-19. « À cette époque, il y avait un grand besoin de données fiables. Grâce aux baromètres que nous avions alors développés, nous avons pu rapidement obtenir un aperçu du nombre d’infections. Plus tard, un baromètre de couverture vaccinale est venu s’y ajouter. Le covid a donc servi de catalyseur pour le développement et l’utilisation de ces outils », souligne le Dr Vaes, qui supervise également le réseau Intego, chargé de suivre les tendances de santé via plus de 130 cabinets de médecine générale et une collecte de données hebdomadaire.
Aujourd’hui, grâce à ces baromètres, les médecins généralistes peuvent travailler à plusieurs niveaux :
- au sein de leur cabinet, pour identifier les tendances et évolutions ;
- dans les Glems, pour échanger avec des collègues et réfléchir collectivement ;
- dans les réunions de concertation multidisciplinaire, où pharmaciens et autres acteurs peuvent partager leurs chiffres et enrichir l’analyse.
Ces connaissances sont cruciales, selon Bert Vaes : « La médecine générale est confrontée à des défis majeurs : vieillissement de la population et pénurie de médecins généralistes. Si nous continuons à travailler de manière principalement réactive, il sera difficile de tenir le coup dans les années à venir. Nous devons aller au-delà de la simple réponse aux plaintes ou aux demandes des patients. Les baromètres peuvent être un outil important. Ils fournissent les informations nécessaires pour mettre en place une approche plus proactive et ainsi dégager du temps pour les patients qui nécessitent une prise en charge plus complexe. »
Retour des utilisateurs et fiabilité des données
Les retours des médecins sont positifs : « Grâce à un questionnaire spécifique, les cabinets participants peuvent nous donner leur avis. Ces enquêtes montrent que les baromètres sont perçus comme un outil précieux et sont régulièrement utilisés », précise le Dr Vaes, qui travaille actuellement à mieux intégrer ces baromètres dans le DMI. « Par exemple, les médecins pourront le faire via un onglet dédié, afin qu'il puissent consulter leurs données directement dans leur propre système, ce qui améliorera grandement l’accessibilité. »
« La qualité du baromètre dépend de l’utilisation correcte du DMI. Plus le DMI est utilisé de manière structurée et précise, plus les chiffres sont fiables. Si, par exemple, les patients diabétiques ne sont pas enregistrés de façon structurée, le système ne peut pas les identifier. Nous voulons donc aussi développer un baromètre qui évalue la qualité des enregistrements eux-mêmes et donne un aperçu de l’utilisation du DMI : les diagnostics sont-ils codés, les vaccinations correctement enregistrées, la déclaration anticipée est-elle présente dans le dossier ? »
Bert Vaes insiste enfin sur un point : « Les baromètres ne sont pas un instrument de contrôle. Ils ont été conçus par et pour les médecins généralistes, pour soutenir leur pratique. Les données des cabinets sont entièrement protégées. Seule le cabinet concerné a accès à ses données individuelles ; celles-ci ne sont jamais partagées avec les autorités. L’administration n’a accès qu’à des données agrégées, comme par exemple le nombre de patients diabétiques ayant eu une mesure de tension artérielle au cours des six derniers mois dans une province ou une zone de première ligne donnée. »