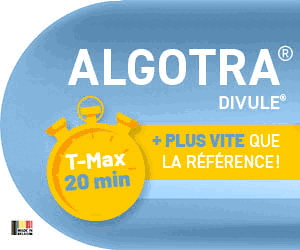La tularémie repointe le bout de son nez
Maladie rare mais à nouveau en hausse en Europe, la tularémie ne concerne plus seulement les chasseurs : des expositions banales, parfois simplement dans le jardin, sont de plus en plus souvent mises en cause. Le diagnostic repose sur une anamnèse fouillée et un PCR précoce, le traitement, sur des antibiotiques actifs en intracellulaire.

La tularémie n’est plus qu’un vieux chapitre des maladies des chasseurs et des lagomorphes, mais une menace à surveiller du coin de l’œil. C’est tout l’objet de l’analyse que le Pr Cyr Jean Yombi, chef du service de médecine interne et de maladies infectieuses des Cliniques universitaires Saint-Luc, a livrée aux médecins anciens étudiants de l’ULB lors d’une journée s'inscrivant dans le 59e congrès de l’AMUB consacrée aux zoonoses émergentes. En Europe occidentale, les chiffres récents évoqués par le Pr Yombi montrent clairement une dynamique à la hausse : plus de 1.000 cas et plus de deux cents hospitalisations en 2023, avec une progression marquée par rapport à 2022. La Belgique n’est pas à l’écart, avec treize cas recensés en 2023, dont douze confirmés. « On voit une augmentation progressive au fil des années », confirme-t-il, en rappelant que le pays n’en déclarait quasiment plus il y a une décennie.
Sur le plan clinique, l’hétérogénéité des formes entretient un certain retard diagnostique. Le Pr Yombi distingue les formes ulcéro-glandulaires (ou simplement glandulaires), la forme oculo-glandulaire, l’atteinte oropharyngée et les formes pulmonaires et typhoïdales. « La forme pulmonaire est extrêmement sévère », insiste-t-il. « La typhoïdale, quant à elle, peut mimer des tableaux fébriles banals, parfois avec diarrhées non sanglantes. » L’éventail des symptômes (fièvre, angine, adénopathies, pneumonie) n’a rien de spécifique, d’où la nécessité de connaître le contexte épidémiologique précis.
Un contexte qui s’étend bien au-delà des seules forêts. Les cas belges ont révélé des expositions variées : morsure de taupe ou de tique, plaie lors du nettoyage en zone de chasse, contact avec des excréments de rongeurs, manipulation d’une peau de sanglier... « Ça peut même arriver dans nos jardins », glisse le Pr Yombi, à propos d’un regroupement de cas dans un même jardin en province du Limbourg. D’où la vigilance requise chez les professions et loisirs à risque : chasseurs, vétérinaires, vendeurs d’animaux, gardes forestiers.
Des molécules actives en intracellulaire
L’agent pathogène en cause, Francisella tularensis, est un coccobacille à Gram négatif intracellulaire, ce qui conditionne le choix des molécules actives. « Il faut des antibiotiques avec une activité intracellulaire », résume logiquement le spécialiste des maladies infectieuses, citant les fluoroquinolones et la doxycycline. « Quand vous me demandez quel est le meilleur antibiotique, je choisis la doxycycline. Je trouve les aminosides toxiques, et leur efficacité commence à être discutée, même si j’admets qu’elles peuvent aider, surtout dans les formes sévères en combinaison au début du traitement. » Faute d’essais randomisés robustes, en pratique, les durées et combinaisons restent affaire d’expertise et de discussion collégiale.
Le message de prévention est clair et rassurant. « Il n’y a pas de transmission interhumaine », confirme-t-il. Les agrégats familiaux traduisent en effet une exposition commune et non un passage d’une personne à l’autre. L’absence de vaccin contre la tularémie impose des mesures simples : hygiène des mains, gants et masques selon l’activité, prudence avec les carcasses et les sols poussiéreux. Une prophylaxie antibiotique peut se discuter au cas par cas, souvent chez les gens très à haut risque.
Les signes qui doivent alerter
Quels signes doivent éveiller une suspicion de tularémie chez le praticien ? « La non-réponse aux antibiotiques classiques, comme l’amoxicilline, doit être le signal pour creuser l’anamnèse et se renseigner sur le métier, les loisirs, les éventuelles expositions aux animaux, des potentiels contacts avec de l’eau non traitée ou des poussières… En clair, devant une ulcération qui traîne avec des adénopathies atypiques, une pharyngite qui ne répond pas au traitement, un tableau respiratoire sévère ou pseudo-abdominal, le doute doit s’installer et conduire à documenter, demander PCR et histologie, et adapter rapidement l’antibiothérapie. » Chez l’hôte immunodéprimé, la vigilance doit être renforcée. Les formes pulmonaires et typhoïdales dominent, avec des tableaux plus sévères et une mortalité non négligeable dans les séries publiées.
Enfin, l’actualité épidémiologique européenne plaide pour une acculturation des cliniciens à cette zoonose émergente. L’enjeu est moins de multiplier les tests que d’affûter l’anamnèse, de déclencher tôt la PCR et d’opter pour un antibiotique actif en intracellulaire. « Le minimum que nous devons connaître tient en peu de mots : contexte, suspicion, prélèvement, traitement adapté », résume le Pr Yombi.
L’ECDC classe la bactérie Francisella tularensis parmi les agents potentiels de bioterrorisme, ce qui impose des précautions de laboratoire spécifiques pour la culture et la manipulation des échantillons. Cet élément ne change rien à la prise en charge clinique de première ligne. Il rappelle toutefois l’importance du dialogue clinicien-biologiste lorsque la suspicion est posée.