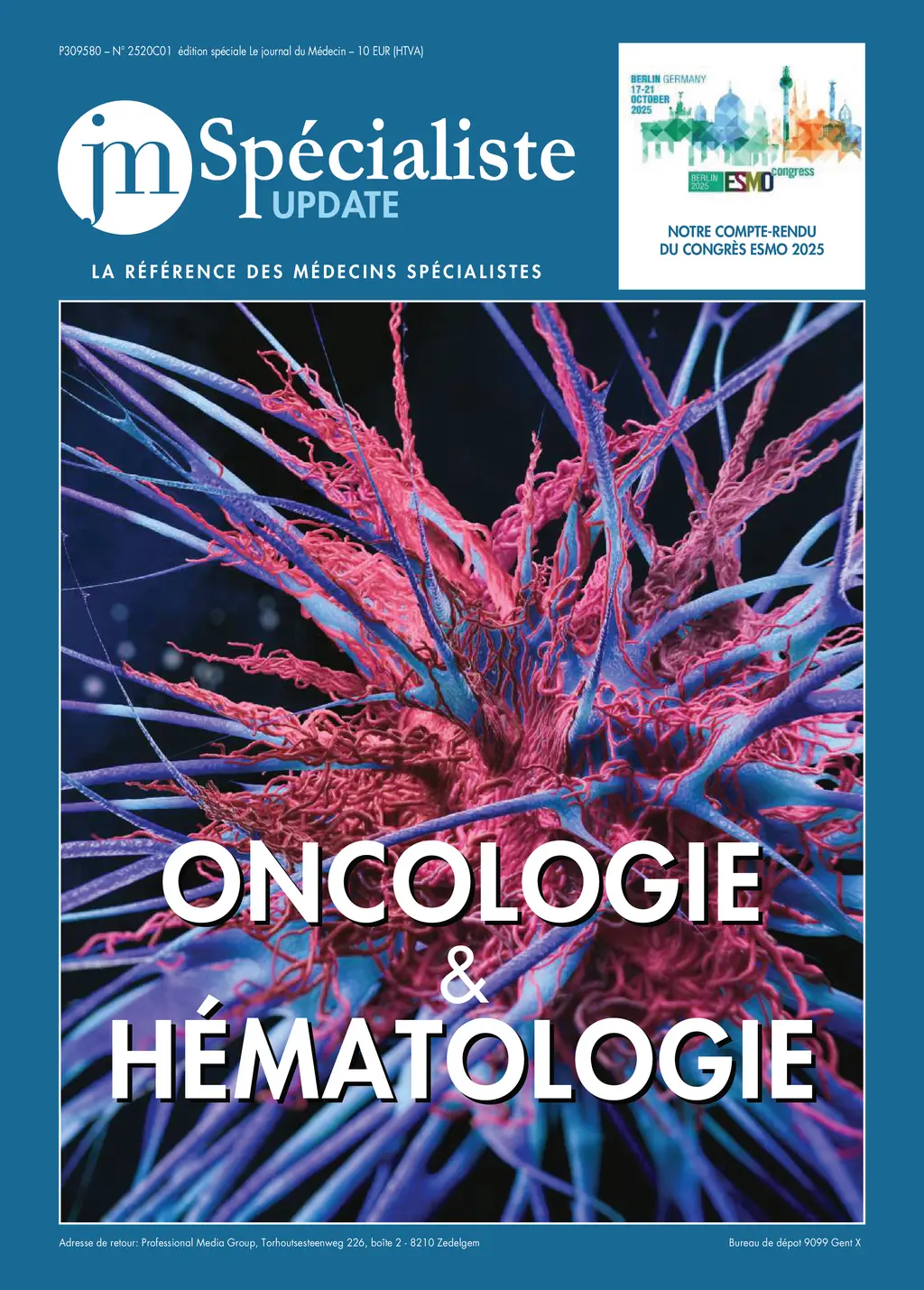Elise Derroitte (II) : « Il y a une grande différence entre le taux d'assurabilité et l'accessibilité »
Elise Derroitte, vice-présidente de la Mutualité chrétienne voit d’un bon œil a priori que plus d’argent soit dévolu pour les syndicats médicaux. Mais à condition de participer pleinement à l’innovation tous azimuts. La Mutualité chrétienne observe attentivement l’avènement de l’Intelligence artificielle. Mais avant de la transformer en outil politique, il faut supprimer les biais qui existent dans les datas que son organisme assureur possède. Celles-ci servent à rembourser pas forcément à définir une politique. Deuxième et dernière partie de notre entretien en intégralité (première partie ici).

Le Journal du médecin : Passons à la révolution de l'intelligence artificielle. Y a-t-il une réflexion à la Mutualité chrétienne à ce sujet ? La prenez-vous au sérieux ? Y a-t-il un risque de perte d'emplois ou de remplacement de vos (nombreux) employés?
Oui, nous prenons cela très au sérieux. C'est très intéressant, d'autant que nous possédons une expertise très grande et très ancienne dans le travail avec les données. L'intelligence artificielle (IA) est un outil supplémentaire qui automatise un certain nombre d'analyses que nous faisions manuellement sur les données. L'IA offre la possibilité de travailler de manière beaucoup plus macro et systémique. Cependant, nous connaissons également les limites et les biais de ces analyses. Typiquement, les données de santé que nous détenons dans les mutuelles ne sont pas rassemblées pour faire de la politique de santé, mais pour rembourser le patient. Elles ne sont pas structurées pour permettre la prévention. Il y a donc un vrai risque et un vrai danger. Si nous voulons utiliser l'IA pour la politique de santé, il est crucial de corriger ces biais. Par exemple, si l'on regarde la consommation de soins des personnes pour anticiper si elles vont tomber en incapacité de travail, c'est a priori inefficace. Il y a plus de chances que les gens tombent en incapacité de travail parce qu'ils ont des comportements inadéquats de consommation de soins avant. On ne peut pas dire : « Vous êtes allé cinq fois chez le psychologue, il y a de fortes chances que vous fassiez un burn-out. » Au contraire, c'est souvent parce que vous sous-consommez avant que vous risquez plus facilement des problèmes de santé mentale. Il y a aussi des biais liés aux personnes qui ont moins accès aux soins, qui ne peuvent pas payer, ou qui ne savent pas qu'elles devraient avoir accès. Il est difficile de modéliser l'information en corrigeant ces biais. Nous sommes très en retard dans ces réflexions. Je vois une forte appétence à vouloir aller très vite pour faire tourner des modèles sur les données en espérant que cela mènera à de grandes politiques et que des solutions sortiront du chapeau. Je suis beaucoup plus prudente. L'IA est un outil précieux, mais il doit être utilisé à partir d'une expertise scientifique et médicale, en insufflant la bonne connaissance pour éviter de tomber dans ces biais.
« Il faut être prudent en parlant de shopping médical. »
J'ai résumé une question parlementaire sur le shopping médical et le nomadisme médical. Un exemple mentionnait une personne visitant 60 pharmacies et six généralistes. On dit qu'il n'y a pas de statistiques claires, mais vous, qui assurez plus de la moitié de la Belgique, devriez en avoir…
Oui, nous pourrions identifier des comportements qui pourraient être qualifiés de shopping médical. Nous prenons cela sous un autre angle : l'inadéquation des soins proposés. Par exemple, nous avons montré que les patientes souffrant d'endométriose consultent beaucoup plus de gynécologues qu'une patiente qui n'en souffre pas, car elles sont sous-diagnostiquées. Leurs plaintes sont mal détectées comme un problème de santé ; elles sont d'abord perçues comme une sensibilité à la douleur. Souvent, elles ne sont diagnostiquées que lorsqu'elles n'arrivent pas à concevoir, et non lorsqu'elles sont plus jeunes et expriment de vraies plaintes. Il faut être prudent en parlant de shopping médical. Il faut aussi s'assurer, dans une dimension d'accessibilité, que le médecin et l'institution de soins s'assurent que ce qu'ils proposent est en adéquation avec la plainte du patient et qu'ils la prennent au sérieux. Nous observons beaucoup d'errance médicale. La consommation de soins est rarement opportuniste ou faite par plaisir. Souvent, l'errance est due au fait que le patient n'a pas trouvé de réponse satisfaisante.
Une étude de l'Inami a rappelé que 5 % des patients concentrent plus de 50 % des dépenses. Avez-vous une réflexion à ce sujet à la Mutualité Chrétienne ? Faut-il mettre en place du case management pour ces patients lourds ?
Oui, il y a du case management. Concernant la gestion des données, le patient n'a pas toujours une vision complète des données disponibles (aspect du droit du patient). Il arrive qu'il refasse plusieurs fois les mêmes tests d'imagerie ou de biologie clinique. Il manque d'homogénéité dans le suivi du patient. Le dossier patient intégré devrait permettre un meilleur case management. Il est vrai que pour les situations très lourdes, les maladies rares ou les patients chroniques lourds, le case management est pertinent, nous y avons réfléchi dans la réforme de la première ligne. Les patients précarisés se retrouvent très difficilement dans le système de santé. Ils peuvent avoir un comportement de consommation inadéquat parce qu'ils ne connaissent pas assez le système et sont en errance. Ils se retrouvent souvent aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge en première ligne. Ils ne réagissent pas assez vite à certains symptômes ou consomment trop peu de prévention. Tout cela conduit à une utilisation des soins aigus, qui sont beaucoup plus chers. Nos analyses sur les inégalités de santé montrent que les patients les plus précaires et vulnérables ont une consommation disproportionnée de soins aigus parce qu'ils ont trop peu accès à la prévention. Nous avons par exemple essayé de travailler avec des community health workers pour accompagner les patients très précaires. Pour moi, il ne s'agit pas seulement de case management, mais aussi de formes de médiation, y compris sociale (comme des traducteurs dans les hôpitaux). Tous ces éléments contribuent à des comportements de soins plus répartis. Cela nécessiterait une politique intentionnelle de réduction des inégalités. Ma conclusion de l'étude IMA est que nous n'avons pas une politique suffisamment sérieuse de réduction des inégalités. Une telle concentration des dépenses signifie que nous ne déterminons pas assez les groupes vulnérables et que nous n'avons pas assez de politiques ciblées par rapport à ces groupes.
Problème d’accès aux soins
Le taux d'assurabilité est très élevé (97 % ou 99 %) dans notre pays. Néanmoins, il y a des gens qui décrochent au niveau de l'accessibilité. Que pouvons-nous faire de plus, car il y a encore des problèmes d'accès aux soins, comme les soins dentaires ?
Il y a une différence entre le taux d'assurabilité et l'accessibilité. L'assurabilité est le degré zéro de l'accessibilité, s'assurant que les gens sont inclus dans le système. Au-delà de ce niveau de base, d'autres seuils entravent l'accessibilité, que nous classons en quatre piliers :
- La sensibilité : les gens qui ignorent qu'ils sont malades (maladies asymptomatiques). S'ils ne sont pas suivis, l'intervention arrive parfois trop tard, conduisant à des soins curatifs lourds.
- L'accessibilité financière : le fait d'être assuré n'empêche pas un « out of pocket » (coût à charge) trop élevé. Le out of pocket en Belgique est de 18 %, contre 9 % en France, si l'on inclut les prestations non remboursables, les suppléments et les tickets modérateurs.
- La disponibilité des soins : la capacité à se rendre dans un lieu de soin, les horaires disponibles, et savoir où aller.
- L'acceptabilité : le fait que ce qui est proposé convienne au patient.
L'assurabilité assure uniquement que les gens sont couverts pour ce qui est remboursé, mais tous ces autres éléments de l'accessibilité ne sont pas encore traités.

On entend souvent que les mutuelles pourraient faire des économies, car elles reçoivent de grosses sommes (un milliard environ). En France, les mutuelles gèrent les complémentaires, tandis qu'en Belgique, vous gérez l'obligatoire et le complémentaire. Quelle est votre utilité par rapport à un système comme le français, et vous verriez-vous ne gérer que les complémentaires en laissant l'assurance obligatoire à une structure comme l'Inami ? Cette question est liée aux piliers politiques. Vous sentez-vous toujours appartenir à un pilier politique, ce qui pourrait être lié à l'origine historique de la place des mutuelles ?
Historiquement, les mutualités se sont constituées autour des complémentaires et ne voulaient pas forcément gérer l'obligatoire. Cela remonte aux caisses mutualistes vers 1947. Je suis très favorable à ce que la mutualité gère l'assurance obligatoire. C'est notre mission principale et la plus importante, et c'est ce qui justifie notre existence. Je considère les complémentaires comme une antichambre de l'assurance obligatoire. Nous essayons d'aller le plus loin possible dans la protection des patients en obligatoire (pour que ce soit accessible à tous). Là où nous n'y parvenons pas (transports non urgents, certains remboursements pour enfants), nous compensons avec les moyens mutualistes de la complémentaire. Notre rôle principal est de cogérer le système de santé comme un mouvement social, avec une gouvernance issue de nos membres, qui nous interpellent sur la gestion. Nous appliquons ensuite la technicité nécessaire. Il est très important que le patient soit directement représenté dans le système de santé. Si c'était une administration, nous perdrions la gestion paritaire, qui est le vivier de notre système belge. La gestion paritaire permet aux professionnels (médecins, pharmaciens, infirmiers) et aux patients de se réunir pour évaluer les besoins et décider de la vision des soins de santé. C'est un modèle extrêmement riche. Nos membres ont des sensibilités différentes (réduction des inégalités, jeunesse, santé mentale, etc.), ce qui fait la richesse de notre modèle. C'est un modèle beaucoup plus efficace qu'un modèle centralisé et bureaucratique. De plus, il existe une concurrence entre les mutuelles, et une vraie proximité. Nous avons des agences partout en Belgique et voyons nos membres tous les jours (presque 100.000 contacts). Les membres qui nous contactent sont souvent ceux qui sont le plus en difficulté.
« Je suis a priori favorable à ce que les syndicats médicaux reçoivent plus de moyens. »
Pour boucler la boucle, seriez-vous favorable à ce que les syndicats médicaux disposent de plus de moyens financiers pour participer pleinement à la concertation ? Ils disposent d'environ un million pour tous les syndicats, et sont souvent dépassés car ce sont des médecins qui cumulent cela avec leur consultation le soir.
Oui, je pense qu'il est utile de permettre que la gestion paritaire se fasse de manière professionnelle, donc je suis a priori favorable. Il faut savoir que la concertation et ce que cela implique n'est pas spécifiquement prévu dans nos frais d'administration non plus ! Nous recevons une enveloppe pour les frais d'administration pour ce faire. Je trouve qu'il faut donner les moyens à la gestion paritaire : des moyens financiers, certes, mais aussi du temps et de la qualité. Il faut laisser la gestion paritaire mener des discussions, faire des accords et proposer des innovations.
Comment qualifieriez-vous les relations entre les représentants des prestataires (pas seulement médicaux) et votre mutuelle ? Elles ont été difficiles par le passé. Sont-elles apaisées maintenant ?
J'ai un grand respect pour le travail fourni par les prestataires. Personnellement, j'ai de très bonnes relations avec la plupart de leurs représentants. J'ai un grand respect pour le travail accompli. Évidemment, nous ne sommes pas toujours d'accord et nous n'avons pas les mêmes fonctions. Nous avons eu des discussions de fond, parfois difficiles, sur le budget. Je comprends l'insatisfaction des coupoles, mais leur travail est absolument fondamental. Nous devons avoir des relations de collaboration qui respectent nos missions et nos mandats. Il est très important, pour les générations futures et pour les syndicats, qu'il y ait suffisamment de renouvellement pour permettre à une nouvelle génération d'intégrer ce modèle. Ce modèle est mal connu, très complexe et difficile à appréhender pour les nouveaux syndicalistes. Il est essentiel de transmettre cette vision de la santé publique, cette vision de la santé comme bien commun. J'ai le sentiment d'un certain désinvestissement de la nouvelle génération par rapport aux syndicats professionnels vis-à-vis de ces enjeux, ce qui se manifeste par un fort déconventionnement. Or, c'est ce qui fait la force et la puissance de notre système de santé belge. Je suis favorable au soutien des organisations professionnelles, mais elles ont un enjeu majeur de renouvellement et de continuité.
Quelle est la principale différence avec le pôle flamand de la Mutualité Chrétienne ? Chez les médecins, on sent une différence (études différentes, médecins francophones plus interventionnistes). Quelles sont les deux grandes différences entre vous, sachant que vous êtes tous les deux au sein de la même mutualité ?
La Mutualité chrétienne est une mutualité qui s'efforce de rester vraiment une mutualité fédérale. Nous travaillons vraiment ensemble sur ces questions. Je pense que l'une de nos forces est justement d'avoir une vision holistique du système. Nous sommes présents dans le système de concertation en Flandre, à Iris Care (Bruxelles) et à l'AViQ (Wallonie), et ensemble au niveau fédéral. Cela nous permet d'attirer l'attention des ministres de tutelle (en Wallonie, Flandre ou au fédéral) sur les réformes. Je ne dirais pas qu'il y a d'énormes différences dans notre vision, mais nous sommes sur des terrains très différents. Les enjeux de la réforme hospitalière en Région Bruxelloise, en Région wallonne et en Flandre n'ont rien à voir. Notre force est justement de très bien connaître les différents systèmes. Nous avons un seul service politique fédéral bilingue et un seul service d'étude bilingue. Nous réalisons toujours des analyses sur l'intégralité des territoires, en essayant de montrer l'impact des politiques, même si elles sont asymétriques.