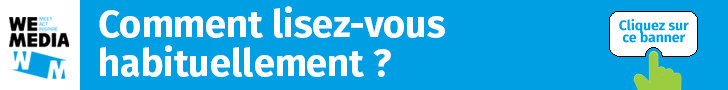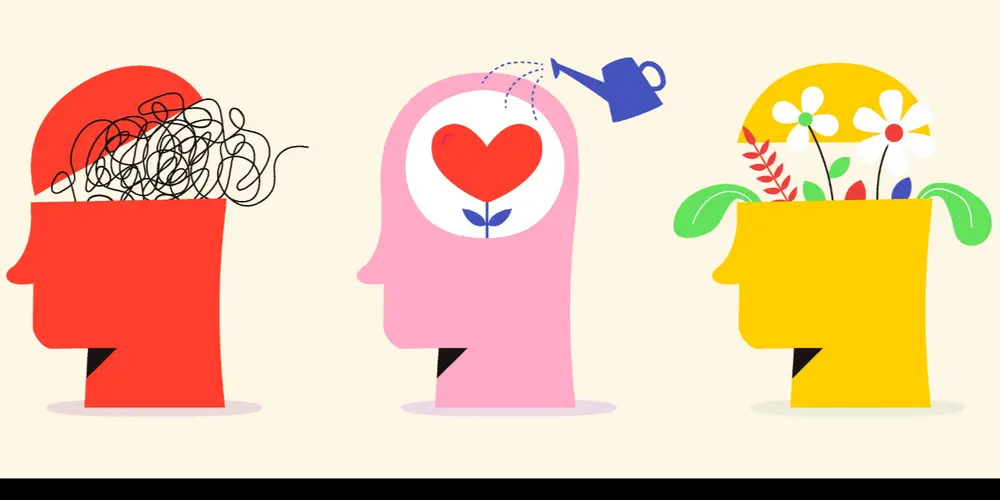Yves Smeets, directeur général de Santhea
« Les hôpitaux sont des porte-avions, on ne change pas leur direction en deux ans »
La rentrée hospitalière s’annonce tendue : budget 2026, réforme du financement, incertitudes sur les pensions et la première ligne. Dans une interview exclusive au journal du Médecin, le DG de Santhea, Yves Smeets, appelle à plus de temps, plus de cohérence et surtout plus de moyens pour éviter le chaos.

Une interview de Laurent Zanella
Le journal du Médecin : Comment abordez-vous cette rentrée hospitalière, suite à un été chaud et quelques mois qui s’annoncent tout aussi tendus avec le budget et les réformes en cours ?
Yves Smeets : Elle ne m’inquiète pas particulièrement parce qu’on a déjà connu ce type de situation. Cela fait trente ans que je fais ce métier et le monde hospitalier n’a jamais été un monde tranquille. Il y a toujours une crise, un problème, un trou à boucher par-ci ou par-là. Nous avons eu des années plus faciles, bien sûr, mais nous sommes habitués à fonctionner dans l’urgence.
Ce qui est plus problématique, c’est la volonté de réformer trop vite, sans se donner le temps et les outils. Quand on veut modifier la nomenclature, il faut prévoir une période de chevauchement, de test. On ne peut pas basculer du jour au lendemain, sinon ça va exploser. Si les hôpitaux ne peuvent pas facturer et être remboursés, ils ferment la porte et mettent leur personnel au chômage.
Les hôpitaux, ce sont des porte-avions. On ne change pas leur direction en deux ans. Il faut du temps pour adapter les systèmes, du temps pour réfléchir sereinement. Pendant la crise du covid, on a vu à quel point il était vital d’avoir des hôpitaux solides. Si on ne leur donne pas les moyens de se transformer correctement, on met en péril ce rôle central.
« On est maintenant fin 2025, on a presque deux ans pour mettre la réforme du financement hospitalier en place. C’est illusoire d’y arriver à temps. » - Yves Smeets
Une réforme du financement jugée irréaliste
Le ministre veut une réforme complète du financement hospitalier d’ici 2028. Où en est-on réellement ?
On est fin 2025 maintenant, on a presque deux ans pour mettre tout en place. Quand on voit le trajet qu’il a fallu pour arriver au stade actuel de la réforme des honoraires, ça nous paraît illusoire d’y arriver à temps.
Il n’existe aujourd’hui aucune équipe qui travaille sur la transition vers un financement par pathologies, les fameux DRG. Et l’institut des DRG que nous réclamions pour piloter la réforme n’a jamais vu le jour.
On ne peut pas, du jour au lendemain, supprimer le BMF et basculer vers un financement DRG. Ça ne marchera pas. Il faut au moins une période de test, un chevauchement entre les deux systèmes, pour s’assurer que tout fonctionne.
Et puis il faut arrêter de penser qu’on peut rassembler tous les financements en deux ans. Aujourd’hui, il y a le BMF, mais aussi le maribel social, le fonds “blouses blanches”, des accords sociaux… Si on veut passer au DRG, il faut rapatrier tout cela. Cela veut dire convaincre les syndicats, le Parlement, abandonner des mécanismes existants. Faire tout cela d’ici 2028 est irréaliste.
La réforme touche aussi aux suppléments d’honoraires. Les hôpitaux sont-ils finalement concernés ?
Pas tellement. À l’hôpital, tout est cadré. On ne peut demander des suppléments d’honoraires qu’en chambre particulière et, dans 90 à 95 % des cas, le patient dispose d’une assurance qui couvre ces frais. Dire que cela coûte directement au patient est faux.
En ambulatoire, c’est une autre histoire. Essayez aujourd’hui de trouver un gynécologue, un dermatologue ou un psychiatre en ville qui travaille au tarif de la convention… ça n’existe pas, en tout cas dans les grandes villes. Et c’est là que se trouve le véritable scandale : la jeune fille de 23 ans qui gagne 1.800 euros par mois et qui doit aller trois fois chez son gynécologue. Elle paie 100 euros à chaque consultation et en récupère 20. C'est ça, le vrai scandale.
Cette situation a aussi des conséquences pour les hôpitaux. Comme tout est strictement encadré chez nous, beaucoup de médecins fuient l’hôpital pour augmenter leurs revenus en ambulatoire. Résultat : on peine à organiser les gardes, à trouver des spécialistes disponibles le soir ou le week-end. Certains préfèrent réduire leur présence hospitalière pour dégager plus de temps en dehors, où ils pratiquent les tarifs qu’ils veulent.
Arrêtons de taper sur le clou des suppléments d’honoraires à l’hôpital. Le problème n’est pas là. Le problème, c’est en ambulatoire, et c’est celui-là qu’il faut affronter.

« Le véritable scandale des suppléments d’honoraires, il est en ambulatoire, pas à l’hôpital. » - Yves Smeets
Des accords aux pensions, les autres dossiers lourds à gérer
On parle déjà beaucoup de l’accord médicomut qui sera compliqué cette fin d’année. En quoi l’accord impacte l’hôpital ?
Honnêtement, l’accord impacte peu les hôpitaux. Nous sommes tenus par la loi à respecter un certain nombre de balises : en chambre commune, ce sont les tarifs applicables, qu’il y ait accord ou non. En chambre particulière, les tarifs sont libres. Donc, pour nous, qu’il y ait un accord ou pas, cela change peu le fonctionnement.
Cependant, ce qui a été peu dit, c’est qu’avec la réforme de la nomenclature, la nature des accords va changer. Aujourd’hui, ils portent à la fois sur les honoraires, les frais de fonctionnement et les investissements. Demain, avec la réforme, ils ne concerneront plus que la partie intellectuelle du revenu des médecins.
Cela pose un problème d’indexation. Le ministre voulait soumettre l’indexation à la conclusion d’un accord. Mais nos frais de fonctionnement, eux, existent quoi qu’il arrive. Le personnel est indexé, l’énergie aussi. On ne peut pas soumettre tout cela à la signature d’un accord medicomut.
Il faut deux mécanismes distincts. S’il n’y a pas d’accord, seule la partie intellectuelle des honoraires ne doit pas être indexée. Mais pas le reste. Sinon, on sanctionne l’institution et les employés, alors que nous ne sommes pas partie prenante de ces négociations.
Je m’inquiète aussi d’une complexité inutile. Le ministre parle de transformer toutes les commissions de convention en commissions d’accord, avec adhésion individuelle. Pour des hôpitaux, ce serait ingérable. On peut simplifier pour les institutions, ce n’est pas la même logique que pour des personnes physiques.
Le projet de loi-cadre met de côté le problème des pensions des agents statutaires, qui reste entier. Pourquoi est-il si lourd pour les hôpitaux publics ?
C’est un gouffre sans fond. Les besoins de financement complémentaire sont estimés à 235 millions au minimum, et ce chiffre ne fera qu’augmenter. Les hôpitaux publics risquent de se retrouver dans l’incapacité de payer. Certains devront verser 20 ou 25 millions de cotisations alors qu’ils font à peine un million de bénéfices.
Le système est absurde. Dans les autres secteurs publics, les pensions sont financées par une caisse commune : enseignants, policiers, pompiers… Pour les hôpitaux, ce sont les pouvoirs locaux qui doivent autofinancer. Résultat : on pénalise des institutions déjà fragiles.
Depuis vingt ans, on a vu les législatures se succéder avec des incitants contradictoires : une fois on encourage la nomination, puis on la décourage, puis on la ré-encourage. Les hôpitaux n’ont jamais été maîtres du jeu.
En l’absence de solution globale, il faut refinancer via le BMF. Aujourd’hui, on reçoit 174 millions pour les cotisations statutaires, il faudrait ajouter ces 235 millions. Sinon, certains hôpitaux publics risquent purement et simplement de fermer.
Réseaux fédéraux et régionaux
Quel avenir voyez-vous encore aux réseaux hospitaliers ?
Pour moi, c’est mort. Le ministre Vandenbroucke l’a dit clairement : dans sa vision, les réseaux sont oubliés. Il veut concentrer les activités dans les grands hôpitaux et transformer les petits en hôpitaux de jour. Ça ne colle pas du tout avec les réseaux tels qu’ils avaient été imaginés.
On a beaucoup investi de temps et d’énergie dans ces structures mais, sans financement, ça n’a mené à rien. Peut-être un ou deux projets ont tenu la route, en cybersécurité ou en dossier patient, mais pour le reste, je ne vois pas de résultats significatifs.
On a donc été très critiques dès le départ. Et aujourd’hui, on s’aperçoit que cela ne fonctionne pas. Les organisations locales de soins (OLS) pourraient à terme remplacer cette logique, à condition que les hôpitaux soient impliqués. Mais là encore, il faudra concilier le rôle territorial des OLS avec le rôle supra-régional de certains hôpitaux, et le rôle tertiaire des hôpitaux académiques.
Sur le plan régional justement, vous regrettez de ne pas être associés au processus de refonte de la première ligne. Vous pouvez expliquer ?
Le ministre wallon a lancé un appel à projets pour créer les OLS, censées structurer la première ligne. Mais les hôpitaux n’y sont pas impliqués. On risque de créer une organisation parallèle, sans cohérence avec la réforme du paysage hospitalier.
Nous suivons cela avec beaucoup d’attention, car si demain on veut réduire les durées de séjour, il faut une articulation fluide entre hôpitaux, première ligne et santé mentale (lire encadré). Or, dans la réforme actuelle, on continue à travailler en silo.
Je prends un exemple concret : aujourd’hui, certains réseaux psychiatriques existent déjà. Mais ils ne correspondent ni à l’organisation hospitalière ni aux nouvelles OLS. Résultat : un manque de lisibilité et parfois des situations absurdes, comme des patients psychiatriques envoyés en urgence à 60 kilomètres faute de place ailleurs.
Nous disons simplement : attention à ne pas réaliser une réforme dont on s’apercevrait ensuite qu’elle est incohérente. Les hôpitaux devront être intégrés, c’est évident. Mais pourquoi attendre et les laisser à l’écart de la réflexion ?
La santé mentale, toujours parent pauvre
Pour Yves Smeets, la santé mentale reste largement absente des réformes en cours. Les appels à projets pour les OLS privilégient d’autres thématiques, comme la vulnérabilité ou les 1.000 premiers jours de l’enfant. « La santé mentale est trop peu prise en compte. On parle beaucoup de son importance dans les discours politiques, mais concrètement, elle est laissée de côté. »
La situation est parfois intenable sur le terrain. « Les quelques hôpitaux qui acceptent encore des patients psychiatriques en urgence reçoivent des personnes envoyées par la police à 60 kilomètres de là. C’est ingérable. »
Ce cloisonnement se retrouve aussi dans l’organisation des réseaux existants, jugés déconnectés. « Les réseaux de soins psychiatriques ne correspondent ni à l’organisation hospitalière ni aux nouvelles structures de première ligne. On travaille encore en silo, alors qu’il faudrait une vision intégrée. »
Pour le directeur général de Santhea, il est urgent de réconcilier le somatique et le psychologique : « On ne peut pas séparer les deux. Si on veut un paysage de soins réellement intégré, il faut traiter la santé mentale comme une partie à part entière du système, pas comme une annexe. »